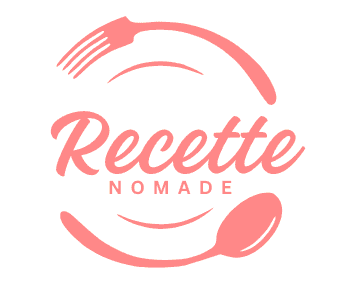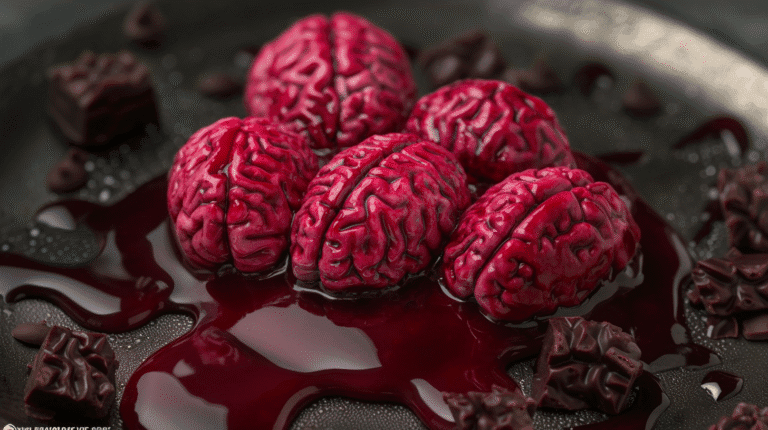La mer offre son premier trésor d’automne : les coquilles Saint-Jacques font leur grand retour en Bretagne
Les premières coquilles Saint-Jacques de la saison 2025 sont arrivées sur les étals bretons cette semaine. Dans la baie de Saint-Brieuc, une centaine de bateaux ont repris la mer à l’aube pour ramener ce mollusque emblématique. Entre tradition maritime et gastronomie, l’ouverture de cette pêche reste l’un des moments forts de l’automne en Bretagne.
Les ports bretons s’animent dès l’aube
Ce lundi matin, le port d’Erquy s’est réveillé avant le jour. À 5h30, une vingtaine de chalutiers quittaient déjà le quai, cap vers les bancs de la baie. Même rituel à Saint-Quay-Portrieux et dans les autres ports de pêche des Côtes-d’Armor. L’ouverture de la saison des coquilles Saint-Jacques mobilise chaque année près de 250 navires sur l’ensemble de la zone.
Les marins connaissent la musique. Vérification des dragues, contrôle des GPS, café brûlant dans la cabine. Certains pêchent la coquille depuis trente ans, d’autres ont repris le bateau familial. Tous partagent cette même excitation à l’idée de retrouver les bancs et de voir remonter les premières prises.
La baie de Saint-Brieuc concentre l’essentiel de l’activité. C’est ici que se trouvent les meilleurs fonds sableux, ceux où la coquille Saint-Jacques se développe dans des conditions optimales. Les pêcheurs travaillent sur des zones précises, cartographiées et surveillées. Pas question d’improviser : chaque secteur a ses caractéristiques, ses courants, sa profondeur.
Vers 8h, les premières dragues remontent. Les caisses se remplissent rapidement. Cette année, les coquilles affichent de beaux calibres. Signe que l’été a été favorable et que le stock se porte bien. Sur le pont, on trie, on mesure, on écarte les spécimens trop petits qui repartiront à l’eau.
Une réglementation stricte pour protéger la ressource
La pêche à la coquille Saint-Jacques en Bretagne obéit à un cadre très précis. Dans la baie de Saint-Brieuc, les sorties sont limitées à 45 minutes par jour, deux à trois fois par semaine selon les périodes. Cette gestion draconienne existe depuis 1994 et a permis de maintenir des stocks viables là où d’autres gisements se sont effondrés.
Les scientifiques de l’Ifremer évaluent chaque été l’état de la population. Ils prélèvent des échantillons, comptent les juvéniles, mesurent les coquilles. Ces données déterminent les quotas de la saison suivante. Le système fonctionne : après quarante-cinq minutes de pêche, les bateaux doivent rentrer, que leurs cales soient pleines ou non.
Les pêcheurs ont accepté ces contraintes parce qu’ils ont vu le résultat. Dans les années 80, les stocks déclinaient dangereusement. La mise en place d’une licence de pêche spécifique et d’un calendrier strict a inversé la tendance. Aujourd’hui, la baie de Saint-Brieuc fait figure d’exemple en matière de gestion durable des ressources marines.
Les contrôles sont réguliers. Les agents des affaires maritimes vérifient les horaires de sortie, les quantités pêchées, le respect des zones. Les infractions coûtent cher : amendes salées et suspension de licence. Mais les cas sont rares. Les marins savent que leur métier dépend de cette discipline collective.
Selon les données de l’Ifremer, la gestion rigoureuse des stocks en baie de Saint-Brieuc permet aujourd’hui de maintenir une pêche durable et exemplaire.
Des coquilles qui reflètent la qualité de nos eaux
Sur les criées, les acheteurs inspectent la marchandise. Ils ouvrent quelques coquilles, vérifient la fermeté de la chair, observent la couleur du corail. Les coquilles Saint-Jacques de la baie ont une réputation à tenir. Leur texture dense, leur goût sucré légèrement iodé, leur calibre généreux : tout cela se construit au fil des mois passés dans une eau riche en plancton.
Cette saison démarre avec des coquilles de belle taille. Certaines dépassent les 110 millimètres, ce qui classe directement dans la catégorie supérieure. La noix est blanche, presque translucide quand elle est très fraîche. Le corail varie du orange vif au rouge brique selon la maturité du mollusque.
Les poissonniers bretons ont reçu leurs premières livraisons dès mercredi. Sur les marchés de Rennes, Saint-Malo ou Brest, les étals se garnissent de caisses ouvertes présentées sur glace. Les prix varient selon les jours et les volumes pêchés, mais la demande reste forte. Les restaurateurs passent leurs commandes à l’avance pour être sûrs d’être servis.
La fraîcheur compte énormément pour ce produit. Une coquille pêchée le matin et consommée le soir offre une qualité incomparable. C’est pourquoi les amateurs privilégient les circuits courts : achat direct au port, sur les marchés locaux, ou chez les poissonniers qui s’approvisionnent quotidiennement.
Des recettes simples qui respectent le produit
Dans les cuisines bretonnes, on ne complique pas les bonnes choses. La coquille Saint-Jacques se suffit à elle-même quand elle est fraîche. Une noix saisie deux minutes dans du beurre salé, c’est déjà un plat complet. Le secret tient à la cuisson : courte et vive pour garder le cœur nacré. Une coquille trop cuite devient caoutchouteuse et perd toute sa finesse.
Le carpaccio séduit ceux qui veulent goûter le produit brut. Les noix tranchées finement, un filet d’huile d’olive, quelques gouttes de citron vert, un tour de moulin. Cette préparation demande une fraîcheur absolue mais révèle toute la douceur naturelle de la chair.
Pour les tablées familiales, le gratin reste un classique indémodable. Coquilles revenues au beurre avec des échalotes, mouillées au cidre brut, gratinées sous une chapelure persillée. Le plat sent bon l’automne et réchauffe les soirées où le vent souffle sur les côtes.
Certains chefs innovent avec des associations plus surprenantes : coquille et topinambour, coquille et butternut, coquille et châtaigne. Ces mariages terre-mer fonctionnent à condition de garder la coquille comme élément central. On l’accompagne, on ne la noie pas sous les saveurs.
Un pilier économique et culturel de la Bretagne
La coquille Saint-Jacques représente un chiffre d’affaires annuel de plusieurs millions d’euros pour la région. Elle fait vivre directement 250 bateaux et leurs équipages, plus tous les emplois indirects : mareyeurs, transporteurs, poissonniers, restaurateurs. C’est une filière complète qui s’active d’octobre à avril.
Mais au-delà des chiffres, la coquille occupe une place particulière dans l’identité bretonne. Les festivals lui rendent hommage, les associations de pêcheurs organisent des journées portes ouvertes, les écoles de cuisine en font un produit d’apprentissage. Elle figure sur les cartes postales, les logos, les enseignes des restaurants côtiers.
Chaque ouverture de saison fait l’événement dans la presse locale. On suit les prévisions météo, on commente les premiers débarquements, on compare avec l’année précédente. C’est un rendez-vous collectif qui marque le passage à l’automne aussi sûrement que les feuilles qui tombent.
Les anciens racontent l’époque où la pêche était moins régulée, où les conflits éclataient entre ports pour défendre tel ou tel secteur. Aujourd’hui, la profession s’est structurée. Les comités de pêche organisent la cohabitation, les scientifiques apportent les données objectives, les autorités arbitrent. Ce modèle de cogestion pourrait inspirer d’autres pêcheries.
La saison ne fait que commencer. Elle s’étirera jusqu’en avril, offrant six mois pour profiter de ce produit d’exception. Six mois pendant lesquels les bateaux sortiront par tous les temps, ramenant chaque fois ces coquilles qui racontent l’histoire d’une Bretagne tournée vers la mer, respectueuse de ses ressources, fière de ses traditions.